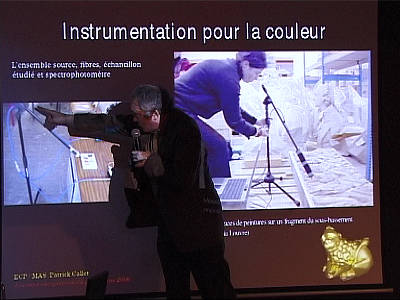Café
des Arts des Sciences
et
des Techniques Café
des Arts des Sciences
et
des Techniquesorganisé
par Ars
Mathématica, accueilli par La Fnac Digitale, en partenariat
avec l'ECE
|
Vingt-Troisième
Rencontre: Pierre-Yves LE POGAM et Patrick CALLET SUR LES TRACES DES COULEURS PERDUES |
| vendredi 12 janvier 2007,
17H30-20H à La Fnac Digitale, 77-81 Bd Saint-Germain, Paris
6e
(Odéon) |
| INTERVENANTS Patrick CALLET Laboratoire Mathématiques Appliquées aux Systèmes Patrick
Callet, né en 1952, diplômé de l'université Paris 6 (DEA Géophysique externe,
propagation d'ondes dans la magnétosphère), docteur de l'Ecole Centrale Paris
(Sciences et Techniques du Bâtiment), habilité à diriger des recherches
(Informatique Graphique), a enseigné
dans le secondaire et le supérieur. Enseigne à l'Ecole Centrale Paris (depuis
1988) et dans diverses formations en école d’ingénieurs (Institut Image),
écoles d'art, d’architecture ou universités. S'intéresse aux développements des
technologies de transfert de l'image et de l'objet (prototypage) au sein de
l'Ecole Centrale dans le cadre de projets d'élèves ingénieurs. Collabore avec
diverses institutions et industriels sur le thème de la couleur (capteurs,
calcul, modèles) et de l'image numérique (CEA, C2RMF, Musée du louvre, Musée
National des Arts Asiatiques-Guimet, Collège de France, Conservatoire des Ocres
et Pigments Appliqués, sté Almiti, sté Axiatec, notamment). Il dirige des
thèses en colorimétrie et synthèse scientifique d’images (simulation spectrale
et réalité virtuelle), financées par de grandes institutions (CNC-RIAM,
CEA-DAM, CG Hauts-de-Seine, etc.) ou des entreprises. Patrick Callet a publié
un "Traité de physique pour imagineurs numériciens" paru aux éditions
Diderot Arts et Sciences : "Couleur-lumière, couleur-matière" (320 p.
+ CD photos) en 1998. Il organise régulièrement diverses manifestations sur le
thème art et science depuis 1996 : "Corot, conservation, couleur,
calcul" avec le LRMF (Laboratoire de Recherche des Musées de France et
l’Ecole du Louvre), Journées "Images et Couleurs" - CNRS et LRMF au
Louvre jusqu'au colloque IRIS à Nancy en novembre 2005 et aux Journées
Européennes du Patrimoine en 2006 à la Basilique de Saint-Denis. En
1997-98 il a participé à la mission « Art Science et Technologie »
commandée par le ministre de l’éducation, sous la direction de Jean-Claude
Risset. Il est Membre de l'Editorial Board de la revue internationale Color
Resarch and Application. Il
est co-fondateur et animateur de l’école thématique interdisciplinaire du CNRS
sur la « couleur des matériaux » à Roussillon (Vaucluse fondée en
2000 sous le nom d'école de printemps « La couleur des matériaux »).
Il est également co-fondateur du GDR-CNRS 2602 « couleur et matériaux à
effets visuels ». Patrick
Callet est membre de l'Association Française d'Informatique Graphique dont il
fut président et de l'association internationale Eurographics ; il est par
ailleurs actuellement vice-président du Centre Français de la Couleur et délégué pour la France auprès de
l'Association Internationale de la Couleur. Il
est responsable de l'équipe Réalité Virtuelle et Simulation du Laboratoire
Mathématiques Appliquées aux Systèmes de l'Ecole Centrale Paris et membre du
Laboratoire de Recherche Commun avec le CEA-DAM-Ile-de-France (Bruyères le
Châtel). Il
est auteur de plusieurs films scientifiques sur le thème de la numérisation 3D,
la réplique physique et la simulation optique ; il prépare avec les Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes un nouveau livre sur le métal et la
couleur. Les derniers films didactiques « Un cheval et des bronzes », traduit en plusieurs langues (chinois, grec, espagnol, portugais, anglais), « Le musée, la grande école et la rue » ainsi que « Sur les traces des couleurs perdues » sont présentés lors de conférences scientifiques (Espagne, Pologne, Grèce, Chine, France) accompagné des répliques physiques obtenues en partenariat avec industriels et musées.  Pierre-Yves LE POGAM Conservateur au Musée du Louvre. Archiviste paléographe, ancien membre de l’École française de Rome et docteur en histoire et histoire de l’art du Moyen Âge, Pierre-Yves Le Pogam a conjugué depuis sa formation à l’École des chartes et à l’université (Paris I, Panthéon-Sorbonne) l’étude des œuvres d’art et des monuments médiévaux avec l’analyse du milieu qui les a produits. Ainsi, il a mené des recherches sur les chantiers des rois de France au XVe siècle et sur ceux des papes au XIIIe siècle en croisant la découverte de documents inédits, l’étude des édifices conservés et une vision globale de la société qui les a vu naître. Au-delà de l’architecture, ses intérêts se portent sur la sculpture, l’iconographie, la vie quotidienne et l’artisanat, pour le Moyen Âge occidental, spécialement à la période gothique (XIIIe-XVe siècles) et pour la France et l’Italie. Pour paraphraser une formule célèbre d’André Chastel, il a donc publié aussi bien sur des palais et des châteaux que sur des coffrets et des cartes à jouer, car aucun témoignage de la civilisation médiévale, du plus impressionnant au plus humble, ne peut laisser indifférent. Il pense également qu’il est important de se pencher sur l’histoire de sa discipline, c’est-à-dire l’histoire de l’histoire de l’art médiéval et dans cette perspective il a publié diverses études portant sur l’histoire du goût, l’histoire des collections, l’historiographie. Pierre-Yves Le Pogam est conservateur au département des Sculptures du musée du Louvre (responsable de la collection médiévale française). Il a été auparavant conservateur au Musée national du moyen âge (Thermes et hôtel de Cluny). Dans ces deux institutions, il a fait acquérir ou restaurer des œuvres d’art, il a réaménagé diverses salles et participé à de nombreuses expositions. Il est l’auteur de deux livres, d’une trentaine d’articles ou contributions à des ouvrages collectifs, et d’une soixantaine de notices de dictionnaires ou de catalogues d’exposition, ainsi que de multiples conférences, interventions radiophoniques ou publications pour le « grand public ». Il a également dirigé plusieurs ouvrages collectifs. Il a enfin enseigné l’art et l’architecture du Moyen Âge à l’université, et surtout à l’École du Louvre et à l’École de Chaillot. CONFÉRENCE SUR LES TRACES DES COULEURS PERDUES
Nous présentons les derniers résultats d'une étude pluridisciplinaire, en cours à l'École Centrale Paris, portant sur la numérisation 3D, la simulation et le prototypage rapide d'objets du patrimoine. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le Centre des Monuments Nationaux et trois laboratoires, ainsi que le Centre de prototypage Rapide Européen d'Assistance, de Transfert et d'Expérimentation (CREATE) de l'École Centrale Paris. Nous étudions une statue médiévale polychrome : le gisant de Philippe Dagobert (XIII` siècle, jeune frère de Saint Louis), dans la basilique de Saint-Denis, nécropole royale. Nos recherches portent sur la représentation 3D d'objets du patrimoine, la simulation de leur apparence visuelle à partir des caractéristiques optiques et physico-chimiques de leurs matériaux constitutifs et l'élaboration de répliques par des méthodes de prototypage rapide . Nous utilisons tout au long de notre travail des techniques et procédés sans contact avec l'œuvre d'art. Après de nombreux travaux sur la représentation des métaux et alliages, nous abordons ici l'étude et la simulation des matériaux de la peinture et de la dorure pratiquées au Moyen Age. Ce travail sur les matériaux devrait se poursuivre en collaboration avec le Louvre et le LRMH (Laboratoire de Recherche des -Monuments Historiques) pour une étude des parties basses du tombeau dont les originaux se trouvent dans les réserves du Louvre. Le rôle de l'éclairage naturel médiéval complète aussi la simulation et permet d'imaginer et comprendre les œuvres étudiées en fonction de leur place et rôle historiques. Ariane Genty, Patrick Callet.
 Philippe dit Dagobert, fils de Louis VIII et frère cadet de Louis IX, était né en 1222 et mourut probablement en 1234. Son tombeau doit avoir été commandé dès la mort du jeune prince et il s'agit donc du premier membre de la famille royale à avoir été enterré dans l'abbaye cistercienne de Royaumont. Le monument funéraire de Philippe Dagobert fut ainsi l'une des premières commandes de sculpture pour l'église abbatiale, consacrée le 19 octobre 1235. L'Occident médiéval avait déjà connu de nombreuses formes de sépulture, dont celle avec gisant et la tombe en forme de "coffre ". Le tombeau de Philippe Dagobert semble être le premier exemple où ces deux formules furent associées. D'autre part les personnages qui entourent le " coffre " ont été considérés fréquemment comme les ancêtres des " pleurants ", un thème qui connaîtra un développement exponentiel à la fin du Moyen Âge. De fait, les moines et les anges qui alternent sous les arcades illustrent à la fois les funérailles terrestres célébrées par l'abbé et ses frères et leur équivalent au ciel, où l'âme du prince va être reçue. La qualité de l'oeuvre, certainement commandée à un sculpteur parisien par la cour, se lit dans l'équilibre entre deux tendances contradictoires : la recherche de la vie, de la vraisemblance, de l'animation, mais aussi la retenue, voire l'austérité sensibles dans la rigueur de la mise en page ou la noble simplicité du gisant. Cependant notre vision actuelle du monument est faussée par l'absence de la polychromie, pour la première fois étudiée complètement dans le cadre du présent projet. L'étude conjointe des restes de couleur encore visibles sur certaines parties du tombeau et des sources écrites et visuelles a permis de distinguer les différentes couches qui furent appliquées au cours des siècles. La polychromie originale, qui coïncidait exactement avec la représentation du même prince dans un vitrail de l'abbatiale, se distinguait par sa palette vive et contrastée, avec des couleurs répondant tantôt à la réalité observée (vêtements luxueux de l'enfant : cotte rouge et surcot bleu décoré de motifs dorés), tantôt à la fantaisie et au goût de la variété (ailes des anges rouges ou bleues). Cet effet d'ensemble ne peut plus se percevoir aujourd'hui, si ce n'est par le moyen de techniques virtuelles. En effet, si le tombeau de Philippe Dagobert s'est conservé intact jusqu'à la Révolution, il a subi ensuite, avec les autres monuments funéraires de Royaumont et l'abbatiale elle-même, le sort qui fut réservé à tous les sépulcres royaux ou de la famille royale. Les sépultures, transférées à Saint-Denis depuis Royaumont, furent englobées dans la profanation générale et les tombeaux furent démontés. Passés par le musée des Monuments français, les fragments subirent de nombreuses reconstitutions successives. La perception du monument dans son contexte et dans son caractère original est donc désormais difficile, mais l'approche conjointe des chercheurs en sciences humaines et sciences exactes permet de tenter sinon une reconstitution complète toujours hasardeuse, une meilleure compréhension de ce chef-d'oeuvre de la sculpture gothique. Pierre-Yves LE POGAM.
|
 |
| >>>
retour <<< |